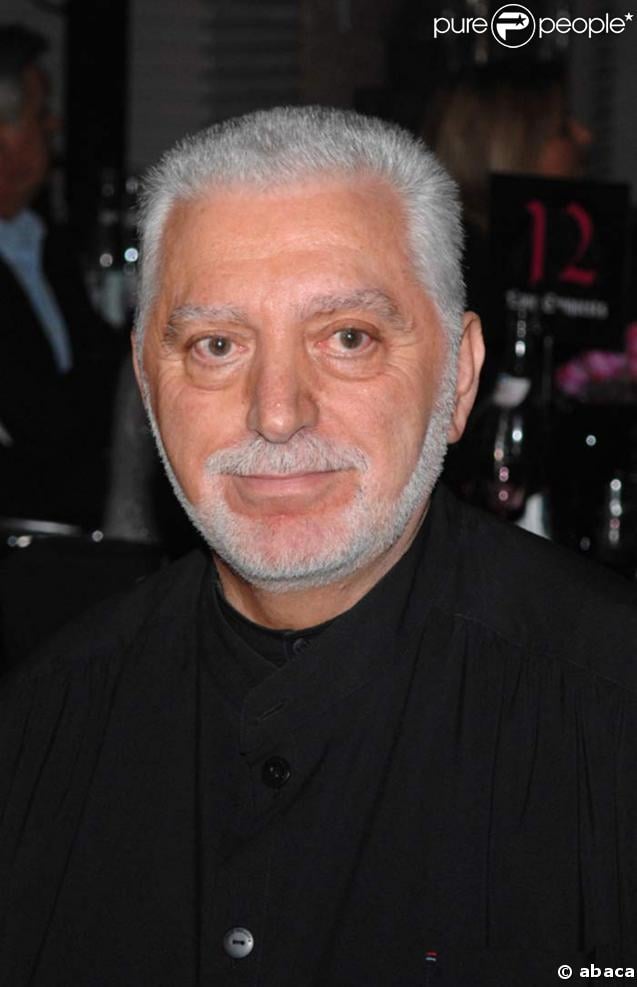Message
par Roland C. Wagner » mar. janv. 31, 2012 4:11 am
J'ai déjà argumenté en long, en large et en travers à ce sujet, ici ou ailleurs, et j'en ai ras le bol de devoir rabâcher des évidences.
De surcroît, j'ai consacré pas mal de textes de fiction à traiter du sujet, par exemple dans les Futurs Mystères.
Alors, bon, il faudra sans doute qu'un jour je me décide à pondre un essai, mais je n'ai pour l'instant pas vraiment le temps de le faire.
La pensée magique, je la connais bien, je l'ai vue à l'œuvre, elle est indissociable de visions du monde imprégnées de vieux mysticisme moisi et de totalitarisme moral. C'est rigolo quand tu as pris des petits champignons qui font rire, ça l'est beaucoup moins quand d'aucuns l'érigent en système de pensée. D'autant moins quand elle emprunte au passage des éléments hétéroclites.
La pensée rationnelle, j'imagine que tout le monde ici sait de quoi il s'agit, je ne m'étendrai donc pas.
Dans Poupée aux yeux morts, j'ai décrit un monde où ces notions étaient brouillées, où le concept de Rationalité suscitait des pratiques pour ainsi dire religieuses associées à un système de valeurs morales d'un puritanisme exacerbé, et où l'intrusion d'anomalies paraissant à première vue relever du domaine de l'irrationnel se révélait au bout du compte la conséquence d'une forme de rationalité plus complexe. Ce qui donnait des personnages dont les raisonnements et la Weltanschauung, tout rationnels qu'ils fussent, se coulaient dans les formes de la pensée magique, et d'autres personnages chez qui une pensée authentiquement rationnelle se heurtait à des faits qu'elle ne pouvait expliquer.
Le truc, c'est qu'il s'agit de deux domaines différents. Derrière la pensée rationnelle, il y a la raison. Derrière la pensée magique, il y a le sentiment. Pour des motifs évidents, on peut argumenter dans le premier cas, pas dans le second. Il suffit de jeter un coup d'œil au contenu des revues scientifiques (et à leur courrier des lecteurs) et de les comparer à ceux des revues d'astrologie ou de mystique new age pour s'en convaincre.
Maintenant, si vous avez envie de voir des miquets pas complètement finis se plaindre ad nauseam qu'il y a trop de science dans les romans de science-fiction tandis qu'ils avalent sans broncher des histoires de dieux et de sorciers dans des mondes qui ont parfois une cosmogonie mais quasiment jamais de cosmologie, pas de problème, les enfants, gardez-la, votre étiquette d'« imaginaire ».
Mais dans ce cas, il faut élargir la catégorie qu'elle recouvre. Sylvaner suggère d'y ajouter John Irving ? Très bien. Mais ça ne suffit pas. Le roman historique devrait en faire partie, de même que pas mal de polars, thrillers et romans noirs. Puisque cette étiquette ne désigne pas des œuvres qui se ressemblent entre elles mais bel et bien des œuvres pouvant être très différentes qui ne ressemblent pas à la littérature — euh — « normale », il ne faut pas hésiter à annexer tout ce qui sort de l'ordinaire.
Comme l'a écrit Sylvie Denis : « La science-fiction tente de décrire l'histoire de l'homme dans l'univers. Elle croit que l'histoire a un but : le futur, et un moteur : la science, au service de l'humanité. »
Je ne pense pas qu'on pourrait dire quoi que ce soit d'équivalent pour l'imaginaire, et sur ce je vais faire dormir les yeux, parce que demain je dois bosser sur un texte de science-fiction et qu'il vaut mieux avoir les idées claires pour ça.
« Regarde vers Lorient / Là tu trouveras la sagesse. » (Les Cravates à Pois)
الكاتب يكتب