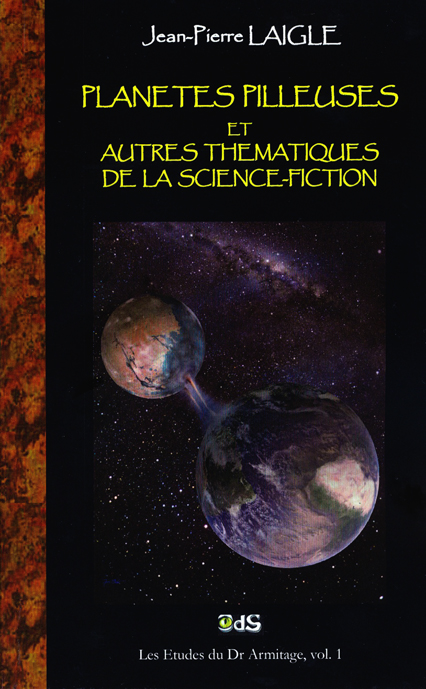
Par « érudition véritable », j’entends celle d’essayistes œuvrant dans des domaines que je prétends connaître correctement et dont je me dis, après lecture de leurs productions : tout bien pesé, je dois constater que je ne savais pas grand chose…
C’est ce qui m’arrive régulièrement lorsque je me plonge dans les études signées Jean-Pierre Laigle (anciennement Jean-Pierre Moumon), et c’est particulièrement le cas avec la collection d’articles entièrement inédits — ou c’est tout comme !— recueillis dans cet ouvrage au titre un peu laborieux, mais je peux vous dire que l’on a échappé à bien pire…
Cinq études au programme, donc, qui brillent toutes par leur originalité :
-« Les planètes pilleuses » (prêtant son titre au recueil)
-« Sur les traces du voyageur temporel »
-« L’Europe sauvage ou les colonies orphelines »
-« Les autres lunes de la Terre »
-« Les enclaves météoriques ».
 Peut-être que, dans le lot, « Sur les traces du voyageur temporel » occuperait la place de l’essai le plus conventionnel — en élargissant beaucoup le sens du qualificatif « conventionnel »…—, dans la mesure où Jean-Pierre Laigle y étudie les « suites » données au roman de Wells, « La machine à explorer le temps » (« The Time Machine », 1895). Les vraies suites, si j’ose écrire, à savoir celles conçues comme telles et se référant explicitement au roman de Wells, qui en reprennent sciemment l’arrière-plan et les personnages. Dans ce cas particulier, des titres viennent immédiatement à l’esprit de la plupart des amateurs de science-fiction, comme « La Belle Valence » (1923), très réjouissant roman de Théo Varlet et André Blondin qui fut réédité par encrage en 1996 (avec « L’Épopée martienne » de Joncquel et Varlet), ou encore « C’était demain » (« Time after Time », 1989) de Karl Alexander, le film éponyme de Nicholas Meyer étant sans doute encore plus célèbre que le roman. Certes. Mais que dites-vous de « Elois y Morlocks, novela de lo por venir » (Barcelone, 1909) du Dr. Lazaro Clendabim ou de « The Man who loved Morlocks : a Sequel to The Time Machine as narrated by the Time Traveller » (Melbourne, 1981), de David J. Lake ? On s’éloigne considérablement des sentiers battus…
Peut-être que, dans le lot, « Sur les traces du voyageur temporel » occuperait la place de l’essai le plus conventionnel — en élargissant beaucoup le sens du qualificatif « conventionnel »…—, dans la mesure où Jean-Pierre Laigle y étudie les « suites » données au roman de Wells, « La machine à explorer le temps » (« The Time Machine », 1895). Les vraies suites, si j’ose écrire, à savoir celles conçues comme telles et se référant explicitement au roman de Wells, qui en reprennent sciemment l’arrière-plan et les personnages. Dans ce cas particulier, des titres viennent immédiatement à l’esprit de la plupart des amateurs de science-fiction, comme « La Belle Valence » (1923), très réjouissant roman de Théo Varlet et André Blondin qui fut réédité par encrage en 1996 (avec « L’Épopée martienne » de Joncquel et Varlet), ou encore « C’était demain » (« Time after Time », 1989) de Karl Alexander, le film éponyme de Nicholas Meyer étant sans doute encore plus célèbre que le roman. Certes. Mais que dites-vous de « Elois y Morlocks, novela de lo por venir » (Barcelone, 1909) du Dr. Lazaro Clendabim ou de « The Man who loved Morlocks : a Sequel to The Time Machine as narrated by the Time Traveller » (Melbourne, 1981), de David J. Lake ? On s’éloigne considérablement des sentiers battus… Quant à la thématique cosmique des « Autres lunes de la Terre », qui me fascine tout particulièrement, je me souviens m’être dit, au moment s’entamer la lecture de l’essai : Jean-Pierre Laigle va sans doute brosser là un savoureux panorama des romans hörbigeriens, avec les lunes qui s’écrasent successivement sur la Terre au fil des ères géologiques, selon la théorie astronomique délirante de l’excentrique autrichien popularisée (?) sous nos climats par les essais un peu hallucinés de l’universitaire Denis Saurat (1890-1958) — « L’Atlandide et le règne des géants » (1954), « La religion des géants et la civilisation des insectes » (1955) » — et les passages que lui consacrent les deux comparses du controversé « Matin des Magiciens ». Eh bien, non ! Je cite Jean-Pierre Laigle :
Quant à la thématique cosmique des « Autres lunes de la Terre », qui me fascine tout particulièrement, je me souviens m’être dit, au moment s’entamer la lecture de l’essai : Jean-Pierre Laigle va sans doute brosser là un savoureux panorama des romans hörbigeriens, avec les lunes qui s’écrasent successivement sur la Terre au fil des ères géologiques, selon la théorie astronomique délirante de l’excentrique autrichien popularisée (?) sous nos climats par les essais un peu hallucinés de l’universitaire Denis Saurat (1890-1958) — « L’Atlandide et le règne des géants » (1954), « La religion des géants et la civilisation des insectes » (1955) » — et les passages que lui consacrent les deux comparses du controversé « Matin des Magiciens ». Eh bien, non ! Je cite Jean-Pierre Laigle :« Écartons encore la postérité littéraire germanique de Hans Hörbiger (1860-1931), théoricien autrichien des satellites disparus. S’y rattachent « The Breaking of the Seals » (« La Rupture des sceaux », 1946) du Britannique Francis Ashton et « Gli Infiniti Ritorni » (« Les Retours infinis », 1961) de l’Italien Marren Bagels. « Buried Moon » (« La lune enterrée », 1936) en décrit même une enfoncée dans la Terre avec ses habitants. Tous relèvent plutôt, à notre sens, de thèmes méritant chacun une étude. »
 Vous remarquerez que, même lorsque Jean-Pierre Laigle évoque ce dont il ne va pas parler, son lecteur apprend des choses… C’en est presque inquiétant ! Et l’on notera aussi que, même sans Hörbiger et ses suiveurs — je parle du point de vue de l’exploitation fictionnelle des théories du cosmologiste amateur —, il reste à notre chercheur de la matière, beaucoup de matière à exploiter : je me demande combien de personnes sous nos climats ont réellement lu le premier opus recensé par Jean-Pierre Laigle entrant dans la thématique en question, à savoir « Kort Verhaal van Eene Aanmerklijke Luchreis en Nieuwe Planeetontdekking » du Hollandais Willem Bilderdijk, paru anonymement, comme chacun sait, en 1813, et présenté en son temps (lointain) comme une traduction du russe… Je ne parle pas là de personnes qui connaîtraient l’existence de ce texte improbable et seraient capables d’en orthographier le titre correctement — déjà une sorte d’exploit en soi —, mais d’érudits francophones qui l’auraient réellement lu et étudié… Personnellement, je ne peux, sur le coup, citer qu’un seul chercheur : Jean-Pierre Laigle.
Vous remarquerez que, même lorsque Jean-Pierre Laigle évoque ce dont il ne va pas parler, son lecteur apprend des choses… C’en est presque inquiétant ! Et l’on notera aussi que, même sans Hörbiger et ses suiveurs — je parle du point de vue de l’exploitation fictionnelle des théories du cosmologiste amateur —, il reste à notre chercheur de la matière, beaucoup de matière à exploiter : je me demande combien de personnes sous nos climats ont réellement lu le premier opus recensé par Jean-Pierre Laigle entrant dans la thématique en question, à savoir « Kort Verhaal van Eene Aanmerklijke Luchreis en Nieuwe Planeetontdekking » du Hollandais Willem Bilderdijk, paru anonymement, comme chacun sait, en 1813, et présenté en son temps (lointain) comme une traduction du russe… Je ne parle pas là de personnes qui connaîtraient l’existence de ce texte improbable et seraient capables d’en orthographier le titre correctement — déjà une sorte d’exploit en soi —, mais d’érudits francophones qui l’auraient réellement lu et étudié… Personnellement, je ne peux, sur le coup, citer qu’un seul chercheur : Jean-Pierre Laigle.Voilà ce que j’appelle de l’érudition véritable. Et il ne faut pas s’y méprendre : les articles de Jean-Pierre Laigle ne se bornent pas à une litanie sans fin de titres bizarres dont ceux de provenance moldo-valaque constitueraient à tout prendre les moins déroutants : de la part de l’essayiste, il y a, à chaque fois, un réflexion en profondeur concernant l’évolution du thème, la manière de le traiter, avec une mise en contexte et en perspective travaillée. On pourra ne pas être d’accord avec certaines prises de position ou argumentations développées par Jean-Pierre Laigle : il y a souvent, dans sa réflexion, un appel à la polémique, au sens fécond du terme, et c’est une excellente chose.
À propos de polémique, certains mauvais esprits se réjouiront à la lecture de la préface signée du Britannique Brian Stableford, dans laquelle ce romancier et théoricien de la science-fiction estimé lance quelques piques au monde de la « recherche universitaire formelle », pour reprendre sa propre formule. Mais, aussi bien, personne ne se reconnaîtra dans les cibles du créateur de Grainger des étoiles… Et de toute façon, n’en doutons pas, universitaires ou amateurs, tous les passionnés de science-fiction, ancienne ou moderne, bengali ou provençale -— et oui ! on trouve des textes de ces provenances analysés au fil des « Planètes pilleuses » — trouveront manière de faire leur miel du type d’approche érudite et thématique à la Pierre Versins brillamment défendu par Jean-Pierre Laigle.
Oncle Joe
PS : On murmure que l’illustrateur Jeam Tag, galvanisé par l’entreprise, aurait, pour la première fois de l’histoire de l’illustration, rendu en avance son travail pour la couverture de ce volume d’essais, mais il s’agit là d’une rumeur assez invraisemblable…






