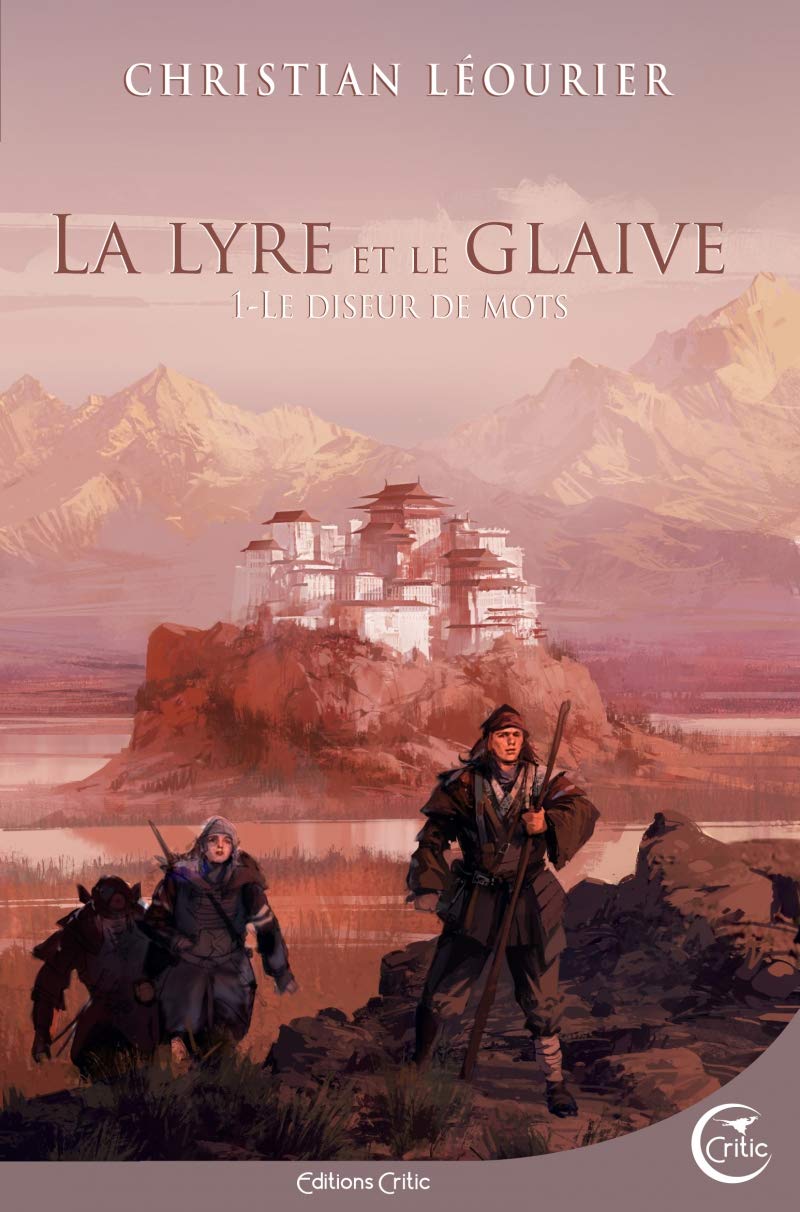Actusf : La Lyre et le glaive est sorti début mars aux éditons Critic. Quel a été le point de départ de l’écriture de ce roman ? Comment est-il né ?
"Comme pour nombre de mes textes, le point de départ été le souvenir d’un paysage. En l’occurrence un pont balayé par une crue glaciaire, quelque part sur la côte méridionale de l’Islande."
Christian Leourier : Comme pour nombre de mes textes, le point de départ été le souvenir d’un paysage. En l’occurrence un pont balayé par une crue glaciaire, quelque part sur la côte méridionale de l’Islande. Je ne parvenais pas à donner une suite à Sitrinjêta car son univers ayant été largement tracé par ce roman, j’avais l’impression de me répéter. J’ai donc décidé de prendre une toute autre direction. Je n’avais jamais écrit de fantasy pour adultes, alors pourquoi ne pas s’y essayer ? Et l’image de ce pont s’est imposée.

Actusf : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’intrigue de La Lyre et le glaive ?
Christian Leourier : Kelt, le Diseur de mots, a acquis un don particulier : tout ce qu’il dit est vrai. Si cela ne l’est pas encore, cela le deviendra. Dans un monde en mutation, aussi bien technique qu’idéologique, un tel don se révèle encombrant pour peu qu’on ait le sens des responsabilités. Ce qui pour certains apparaîtrait comme un moyen de forcer le destin fait de lui le jouet des circonstances. L’action du roman, qui décrit le basculement d’une époque, ne résultera pas tant de sa volonté que de ses rencontres : le seigneur bâtisseur Skilf, la dirse Æsa, Varka la danseuse, Hòggni le mercenaire… chacun à sa manière, de son point de vue, témoigne de cette mutation.
Actusf : Kelt, le diseur de mot et Hòggni, un mercenaire en mal de contrats forment un duo assez improbable. Comment l’avez-vous créé ? Ont-ils toujours suivi le chemin que vous leurs destiniez ou n’en ont-t-ils fait qu’à leurs têtes ?
"Je ne dirais pas qu’ils m’ont échappé, mais, comme cela arrive souvent, de leur personnalité sont nées des situations que je n’avais pas préméditées."
Christian Leourier : Kelt est un idéaliste que la réalité malmène ; Hòggni est plus pragmatique. Leur réunion leur permet à tous deux d’avancer sur des chemins qu’ils n’auraient pas parcourus seuls. Si Kelt est le personnage principal, Hòggni est davantage qu’un faire-valoir. Leur rencontre est due au hasard, mais pour l’un comme pour l’autre, on peut remonter les enchaînements des causes qui conduisent à cette jonction. Ensuite… Je ne dirais pas qu’ils m’ont échappé, mais, comme cela arrive souvent, de leur personnalité sont nées des situations que je n’avais pas préméditées.
Actusf : Une ambiance nordique, de la magie, des soucis de religion… Ce récit est mélange des genres. Est-ce qu'écrire ce roman vous a demandé beaucoup de recherches ? Comment avez-vous procédé ?
Christian Leourier : Ce n’est pas un roman historique, pour lequel il serait nécessaire de vérifier la plausibilité de chaque situation. Il n’a donc pas nécessité de recherches particulières. Pour autant, afin d’assurer la cohérence de l’ensemble, je me suis appuyé sur des connaissances acquises pendant de (déjà trop) nombreuses années, en histoire, en mythologie, en ethnologie... Je me suis aussi fondé sur ma mythologie personnelle, en particulier en ce qui concerne la symbolique liée aux états de l’eau.
Actusf : Lorsque vous écrivez, vous avez toujours un plan ou laissez-vous votre plume vous guider ? Comment construisez-vous votre intrigue et votre univers ?
"Je n’écris pas de façon linéaire, mais par scènes dont j’ai une approche très visuelle, cinématographique. Ainsi, les dernières pages ont été écrites très tôt, peu après le premier chapitre."
Christian Leourier : Je suis incapable de suivre un plan : si j’ai l’impression de connaître toute l’histoire, je n’ai plus envie de la raconter. Je démarre quand j’ai un thème, un point de départ (qui, in fine, ne sera pas forcément celui du roman), une thématique et une fin. Dans le cas du Diseur de mots le point de départ (la chute du pont) ouvrait sur la thématique de l’impermanence. Vint ensuite la question : si tout est fluctuant, y a-t-il quelque part une vérité stable que l’on peut démêler, ou est-on condamné à créer sans cesse des « vérités » provisoires, approximatives ? Mais dans ce cas, peut-on parler de connaissance, ou s’agit-il de simple croyances ? Il ne restait plus ensuite qu’à trouver des personnages et des situations qui illustrent le propos. Je n’écris pas de façon linéaire, mais par scènes dont j’ai une approche très visuelle, cinématographique. Ainsi, les dernières pages ont été écrites très tôt, peu après le premier chapitre. Ces scènes constituent les vertèbres du récit, qui petit à petit prend chair. Au fur et à mesure se mettent en place la géographie (quelquefois circonstancielle, mais le plus souvent symbolique), les mœurs qui vont distinguer les peuples ou les couches sociales, etc.

Actusf : Pourquoi choisir d’écrire de l’imaginaire ? Est-ce plus facile pour exprimer des idées ou envoyer un message ? L'écriture vous permet-elle de dénoncer certaines choses, parler de certains sujets ? Je pense notamment à ce culte au Heldmark qui menace la stabilité du Royaume.
"Or les littératures de l’imaginaire se prêtent particulièrement à la réflexion, en ce qu’elles interrogent le monde par le biais d’un décalage avec la réalité immédiate. Le fameux miroir de Stendhal est, dans ce cas, un miroir déformant — mais il reste, puisque c’est sa nature, réfléchissant. En cela, les littératures de l’imaginaire sont bien les héritières du roman philosophique."
Christian Leourier : Quand j’ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé la question du genre. Lecteur assidu de science-fiction, j’ai spontanément écrit un roman de science-fiction. Plus tard, j’ai aussi écrit quelques romans historiques (pour la jeunesse) et même un roman de littérature « blanche » (qui flirtait, il est vrai, avec le fantastique). Pour moi, le propos de la littérature n’est pas de refléter le réel, mais de l’interroger. Un texte vaut par son récit, son écriture, mais aussi (et j’ai parfois tendance à penser surtout) par son ou ses sous-texte. Or les littératures de l’imaginaire se prêtent particulièrement à la réflexion, en ce qu’elles interrogent le monde par le biais d’un décalage avec la réalité immédiate. Le fameux miroir de Stendhal est, dans ce cas, un miroir déformant — mais il reste, puisque c’est sa nature, réfléchissant. En cela, les littératures de l’imaginaire sont bien les héritières du roman philosophique.
Actusf : Avez-vous des inspirations en particulier ? Des influences ?
Christian Leourier : La réponse est bien évidemment oui. Mais il est plus difficile d’entrer dans les détails, sauf à dresser un inventaire qui irait de l’Iliade à Ursula Le Guin en passant par les sagas islandaises et les classiques chinois, pour ne parler que de littérature — car il faudrait y ajouter le cinéma et les paysages, naturels ou urbains, qui jouent un grand rôle dans mon « inspiration ».
Actusf : Avez-vous d’autres projets en cours ou à venir ?
Christian Leourier : En mai 2019 paraîtra dans la collection Hélios la réédition de La Planète inquiète, un roman de science-fiction déjà ancien, dont je me suis aperçu à la relecture qu’il contient déjà des thèmes présents dans Diseur de mots : l’impermanence, la croyance…
Pour 2020, puisque j’ai eu l’imprudence d’annoncer un diptyque pour La Lyre et le glaive, il me faut écrire la suite, Danseuse de corde.
Pour 2020 également, je prépare la réédition aux éditions Critic, sous forme d’une intégrale, des aventures de Jarvis, une série de romans pour la jeunesse parus en leur temps chez Hachette.
D’autres projets demeurent pour l’instant à l’état embryonnaire, mais me promettent encore quelques années d’activité.

Actusf : Où les lecteurs pourront-ils vous retrouver en dédicace ?
Christian Leourier : Je serai présent aux Imaginales d’Épinal du 23 au 26 mai, aux Étonnants Voyageurs de Saint-Malo du 8 au 10 juin, à Livre o cœur d’Orléans le 20 octobre, aux Utopiales de Nantes du 1er au 3 novembre et aux Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres en novembre.