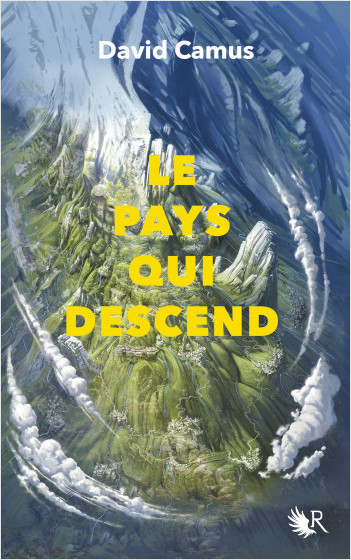Editeur et traducteur émérite de Lovecraft, David Camus est également un écrivain passionnant. Il y a quelques semaines sortait Le Pays qui descend chez Robert Laffont, premier tome d'un dyptique mettant en scène un peuple dans une gigantesque montagne dont la culture est entièrement tournée vers l'aval, et une héroïne qui va elle bien devoir aller voir ce qu'il y a en bas... Interview...
Actusf : Comment est née l'idée de ce roman, Le Pays qui descend ?
David Camus : J’évoque tout ça dans ma postface à « La Terre qui monte » (la suite et fin du « Pays qui descend », qui doit paraître en 2024), mais puisque tu me poses la question je vais tenter d’y répondre. D’abord, j’avais ça en moi depuis longtemps. Ça remonte à décembre 1989, à l’époque où j’étais jeune étudiant. Je traversais une période difficile de ma vie et j’avais vu – alors que je marchais dans la rue – se dessiner devant moi deux pentes : l’une qui montait, et l’autre qui descendait. Tout en moi me poussait à suivre la pente descendante. Celle où on se laisse aller, où on prend soin de vous, où on n’a à s’occuper de rien. Mais je savais que ça n’était pas possible. Alors j’ai pris (mentalement) celle qui montait. Ça voulait dire continuer, avancer, progresser – même si ça n’était pas facile, même si avec de nombreuses pauses. L’idée, donc, c’était ces deux pentes. Une qui descend, une qui monte. Mais comme le proverbe chinois dit « Qui veut gravir une montagne commence par le bas », j’ai choisi de commencer mon diptyque par « Le Pays qui descend ».
Actusf : C'est un monde complet avec ses zones d'ombres et ses mythes. Comment as-tu imaginé le background ? As-tu une bible quelque part de tout ça ?
David Camus : Oui j’ai effectivement une bible. D’ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de la Bible pour le background, et notamment du mythe de l’arche de Noé. A propos de l’arche de Noé, je m’étais demandé ce qu’on pouvait ressentir en retrouvant sa terre après tant de temps passée sous les eaux. Je trouvais que ce passage (la descente) méritait d’être développé. Je m’étais dit aussi : « Qu’est-ce que ça ferait si Dieu n’avait pas pardonné aux hommes ? » On descendrait, et descendrait, et descendrait depuis le sommet de l’Ararat où s’est posée l’arche, et puis rien, toujours pas de terre d’origine. En fait, Dieu n’aurait pas pardonné aux hommes, qui seraient donc éternellement condamnés à redescendre jusqu’à cette mythique terre des origines, que j’appelle « Tout En Bas Tout En Bas » dans mon livre.

Actusf : Le plus gros mythe c'est donc celui de la descente, d'aller toujours plus bas et ne jamais remonter. Tu prends un peu à contrepied les histoires d'alpinisme ou celles où on lutte contre le vent. C'est un objectif faussement facile pour les héros... Cela semble accessible de descendre, mais en vrai c'est aller vers l'inconnu...
David Camus : C’est un monde en pente – donc ardu, par définition. Je crois qu’on aurait d’ailleurs tort de sous-estimer la descente. Je ne crois pas qu’elle soit par essence plus facile que l’ascension – il est facile de déraper, de lâcher prise, et de se casser le cou. D’ailleurs, comme je le dis dans mon livre : « Descendre n’est pas tomber. Tomber, même une pierre peut le faire. » Descendre, ça s’apprend, donc. C’est ce que j’ai voulu montrer dans mon livre. On descend, on descend, vers un inconnu d’où personne n’est jamais remonté (car mon monde est régi par cette loi d’airain : « Toujours descendras, jamais ne remonteras »), sans savoir si « Tout En Bas Tout Bas », cette terre mythique « où même l’eau se repose » existe, sans même savoir si son voyage a un sens et si les risques qu’on prend méritent d’être pris.
Actusf : C'est d'ailleurs un monde assez dur. Par tradition ou idéologie, des gens meurent par exemple en se jetant dans le vide avec le sourire. Et d'autres peuvent être expulsés sans autre forme de procès de chez eux. Tu voulais un univers difficile à cause des règles imaginées par les hommes ?
David Camus : Je voulais un monde difficile parce que la vie est difficile. D’une certaine manière, cette histoire est une allégorie – celle du passage du monde de l’enfance au monde des adultes. Et le passage est rude. Alors oui, on peut voir mon monde comme une image renversée du nôtre : chez nous, des gens adorent le « Très Haut ». Dans mon monde, des gens adorent le « Très Bas ». Chez nous, on souhaite à nos enfants de gravir l’échelle sociale. Dans mon monde, les parents souhaitent à leurs enfants de « tomber bien bas ». L’idée, c’était de se mettre dans l’esprit de gens considérant que ce qui est « bas » est « bien », et que ce qui est « haut » est « mauvais ». Mais, au final, c’est tout aussi absurde que dans notre monde.
Actusf : On y suit une jeune fille, Li, qui fête ses 15 ans avec ses parents adoptifs. Est-ce que tu peux nous raconter qui elle est au début du livre et comment tu la vois?
David Camus : Au début c’est une simple jeune fille, heureuse de vivre avec ses parents, et malgré tout animée d’une certaine colère à l’idée qu’elle a été adoptée et donc qu’elle ne connait pas ses véritables origines. Son voyage sera l’occasion de découvrir celles-ci, et de se confronter à un monde qu’elle n’a bien évidemment pas choisi. On peut parler d’un roman d’apprentissage, d’une quête initiatique, au sens classique du terme. Elle se découvrira des forces qu’elle ne pensait pas avoir.
Actusf : C'est un diptyque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite ? Et sur tes projets ?
David Camus : La suite (et fin) du « Pays qui descend » est déjà écrite. Elle s’intitule « La Terre qui monte ». Je pense qu’on peut deviner au titre de quoi il s’agit. Bizarrement, je suis resté bloqué dix ans sur cette suite. Je pensais l’écrire dans la foulée du tome 1 (dont j’avais fini le premier jet en 2013), et puis j’ai été bloqué juste après la première phrase. Pendant dix ans je n’ai plus été capable d’écrire de romans, à cause de cette fameuse première phrase et du défi que constituait pour moi la remontée… En ce qui concerne mes projets, le plus immédiat consiste donc à relire « La Terre qui monte » avant de l’envoyer à mon éditeur. Ensuite, je reprendrai la traduction de la correspondance entre Robert E. Howard et H. P. Lovecraft. Lovecraft est un auteur qu’il me tarde de retrouver. J’ai passé plus de dix ans à travailler sur son œuvre et je pense que nous ne sommes pas prêts de nous quitter. Ecriture et traduction, donc. Toujours.