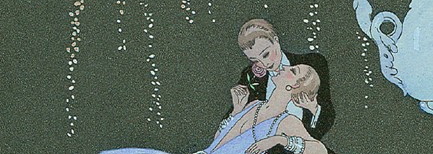A l'occasion de la publication de l'anthologie Années Folles ! , aux éditions Rivière Blanche, Jérôme Akkouche et Tepthida Hay reviennent sur la création de cet ouvrage.
Actusf : L’anthologie Années folles ! est parue fin 2020 chez Rivière Blanche. Comment celle-ci est-elle née ?
Jérôme Akkouche : Grâce à mon expérience sur l’anthologie Dimension Routes de légendes – Légendes de la route, chez Rivière Blanche, codirigée avec Estelle Faye. L’expérience m’a tellement plu, que je me suis juré de diriger à nouveau un tel recueil. Quant aux Années folles, ce sont elles qui se sont imposées à moi, c’est une de mes périodes historiques favorites : une de mes nouvelles publiée dans Dimension Uchronie 2 se déroulait déjà durant cette période.
En revanche, conscient de la masse de travail que la direction d’une anthologie implique, j’ai proposé à Tepthida Hay de me suivre dans cette aventure. J’avais découvert la plume de Tepthida dans plusieurs anthologies, Estelle et moi avions d’ailleurs retenu sa nouvelle pour Dimension Routes... De festivals en festivals, nous sommes devenus amis et comme elle m’avait fait part de son envie de diriger, elle aussi, une anthologie, je n’ai plus hésité le moment venu…
Tepthida Hay : Pour ma part, je ne connaissais que les grandes lignes des Années folles, j’avais étudié (et détesté, j’en ai peur) Gatsby le Magnifique à la fac. Je n’avais pas d’attirance pour cette époque, honnêtement, en dehors des rythmes de jazz. Mais lorsque Jérôme s’est présenté avec son « projet secret », son enthousiasme a été si communicatif que je me suis laissée embarquer dans l’aventure ! J’avais une grande envie de diriger une anthologie, et c’était l’occasion rêvée. Jérôme m’a fait une remise à niveau avec des documentaires à regarder, des références de livres, et maintenant, sans être incollable, j’aime beaucoup la richesse de cette période vertigineuse.

Actusf : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur celle-ci ? De quoi cela parle-t-il ?
Jérôme Akkouche : Années folles ! est une anthologie qui revient de loin. A l’origine, nous devions la publier dans la collection « Dimension » de Rivière Blanche, mais la covid-19 a fauché cette série de recueils. Aussi Philippe Ward, qui a toujours soutenu le projet, a décidé de faire passer notre travail dans la collection Hors-Série au sein de laquelle il éditera désormais ses coups de cœur sous le sceau d’ « I Cal Ana » : « En avant ! », en occitan.
Pour faire simple : Années folles ! est une anthologie dont les textes se focalisent sur une période historique précise (et courte), sans limite spatiale. Pour les nouvelles, tous les genres sont les bienvenus, et presque tous les grands courants de la SFFF sont représentés : fantastique, Urban Fantasy et même… science-fiction !
Tepthida Hay : Jérôme l’a dit : Années folles ! revient de loin ! Pour le centenaire du début de la décade, l’anthologie se devait de revêtir ses habits de lumière. Ce qu’elle a fait, malgré ces longs mois étranges qui se sont étirés, avec leur lot d’incertitude concernant l’impression, l’avancement du BAT en catastrophe pour pouvoir sortir à temps en 2020, tout de même. Grâce à la confiance de Philippe Ward, notre projet a vu le jour. Des petits soucis d’approvisionnement (dus à la situation sanitaire et au Brexit concernant l’imprimeur) retardent un peu l’arrivée chez les lecteurs, mais la situation ne tardera pas à se débloquer. L’anthologie s’attache à présenter cette brève et intense période historique sous un angle imaginaire. Cela peut paraître plutôt pointu, mais la variété d’auteurs et de genres saura je l’espère séduire les curieux.
Actusf : Une anthologie est recueil de nouvelles de différents auteurs. Comment avez-vous travaillé ? Quelles sont les différentes étapes ?
Jérôme Akkouche : Tepthida et moi avons trouvé très vite nos marques en tant que duo de travail, entre méthodologie (c’est la reine des tableaux Excel) et nos sensibilités respectives.
Nous avons rapidement élaboré un calendrier que nous avons respecté au mieux. Au lieu de voir le jour en septembre/octobre, l’anthologie a vu le jour en décembre cause… pandémie mondiale. L’appel à texte a été diffusé dès juin 2019, sur un maximum de plateformes, avec une date butoir au 30 novembre de la même année. A partir de là, Tepthida et moi avons lu chacun l’intégralité des textes (pas loin d’une soixantaine) et avons fait des retours dès décembre.
Nous savions quelle anthologie nous voulions. Qu’elle soit courte, environ une quinzaine de textes, afin de donner envie d’en connaître plus aux lecteurs, quinze textes aussi pour des raisons plus pragmatiques. Une anthologie à seulement 20 euros s’achète plus facilement sur un coup de cœur ou par simple curiosité… et son format reste idéal pour être glissé dans une boîte aux lettres !
Le choix des textes dépendait de plusieurs critères, outre ceux précisés dans l’appel à textes (nombre de signes par exemple), il s’agissait de débusquer les textes les plus surprenants, ou les plus originaux chacun dans leur genre.
Évidemment, entre l’amitié et l’expérience du milieu nous avons invité des auteurices connus à nous proposer des textes tels Estelle Faye (avec une nouvelle mêlant Prohibition, dieux nordiques ( !), western et jazz), mais aussi Emmanuel Chastellière qui nous a offert un inédit de son univers Célestopol, (dont le second tome Célestopol 1922 paraîtra en mars 2021 aux éditions HSN), et enfin, un des meilleurs nouvellistes contemporain : Bruno Pochesci (avec une nouvelle qui part des années 1920 et s’achève dans les années 2020…).
Une chose à laquelle je tenais était que chaque auteurice non retenu ait un retour personnalisé sur sa nouvelle, quelques lignes qui puissent l’aider et surtout le ou la conforter dans son désir d’écriture. Ce n’est pas parce que l’on n’est pas retenu une première fois qu’il faut renoncer. De plus, je considère que cette politique du retour est une courtoisie des plus élémentaires.
A partir de janvier a débuté l’incessant ballet des allers retours des… doubles corrections éditoriales ! En effet si un(e) auteurice achevait son cycle de correction avec l’un, il ou elle ne faisait que commencer avec l’autre… cela jusqu’à avoir la version la meilleure dans les temps impartis. Les corrections éditoriales sont vraiment le cœur d’une anthologie. Lors du choix des textes, il faut savoir aussi sentir les auteurs capables de bouger les lignes de leurs textes, ceux qui sont capables de réagir aux propositions faites. Il s’agit de travailler en bonne intelligence et toujours avec bienveillance afin de livrer le texte le plus abouti.
Nous pouvons dire que l’anthologie a été « validée » en mai 2019 par Philippe Ward et mise sur le marché dès le 1er décembre 2020, soit un an et demi pour passer d’un rêve à une réalité.
Je tiens d’ailleurs à souligner ici l’implication de Philippe Ward qui nous a fait une confiance totale sur nos choix, tout en sachant être réactif dès que nous le sollicitions. Qu’il s’agisse de répondre à nos interrogations ou celles des auteurices. Encore un grand merci à lui !
Tepthida Hay : Une fois les textes reçus, nous avons chacun de notre côté procédé à leur lecture. Nous avons fait un fichier avec un résumé, les points positifs et les points négatifs. Puis nous avons confronté nos ressentis pour savoir quel texte aurait sa place dans l’anthologie. Lorsque nous n’étions pas d’accord, nous argumentions pour que tel texte trouve sa place ou non au sein de l’ouvrage. Ce fut parfois difficile, mais nous avons défendu nos favoris avec ferveur.
Ensuite, chacun a fait ses relectures, corrections, suggestions et entamé le ping-pong auteur-anthologiste. C’est une phase assez stimulante, car elle conduit à des recherches pour compléter ou vérifier tel terme, tel événement, etc. J’ai adoré traquer les redondances (un gros travers quand j’écris des nouvelles), me décortiquer les neurones pour savoir par quoi les remplacer.
Enfin, nous avons relu et relu le fichier définitif, avons harmonisé la présentation des quinze nouvelles, avant de passer la main à l’éditeur Philippe Ward.
Actusf : Y-a-t-il des difficultés particulières dans la création d’une anthologie ? Qu’est-ce qui vous plaît dans ce format ?
Jérôme Akkouche : Je dirais qu’il y a différents degrés de difficulté. Tout d’abord, il faut mettre en forme l’ouvrage que l’on a en tête. Pour cela il faut donner une cohésion à cet ensemble de textes répondant à différents styles et genres d’écriture. Faire que ces nouvelles battent à l’unisson. Qu’elles s’enchaînent naturellement, et pour cela leur impulser un mouvement.
Tepthida et moi avons vite choisi la nouvelle de Lucie Heiligenstein pour ouvrir le bal, et comme il s’agissait de celle qui se déroulait le plus tôt dans les Années folles, nous avons ainsi opté pour un déroulement chronologique. Cela donne au lecteur l’impression d’avancer dans le temps. De s’éloigner de la Première Guerre Mondiale, de s’enivrer, vivre, aimer, et toujours de se rapprocher du Jeudi Noir… mais heureusement, il finira par voyager dans l’espace !
Nous souhaitions à la fois qu’un maximum de genres de la SFFF soient représentés et qu'on explore des thématiques inattendues… En effet, nous avons reçu de nombreux textes mettant en scène les Fitzgerald ou la Prohibition, mais un seul sur les « filles du radium », ces ouvrières qui manipulaient de la peinture radioactive. Comme ce texte était de grande qualité et qu’il n’était pas en concurrence avec d’autres, il a été sélectionné…. Primeur a été donnée à la surprise, aux coups de folie aussi, lorsque cette folie dans le fond, et la forme ( !) correspondait à celle de l’époque. Ce qu'on retrouve dans le texte de Philippe Caza ou encore celui d’Anthony Boulanger…
Tout comme j’évoquais le nombre de textes ou le prix de l’anthologie, nous nous sommes vite posé la question de l’illustration de l’ouvrage. Il fallait créer un bel objet. Les Années folles sont une période si spécifique que nous souhaitions rester dans le ton de celle-ci. Lors de mes recherches, j’ai découvert le travail de George Barbier, un célèbre illustrateur de l’époque… Nous avons organisé une vote auprès de nos auteurices pour départager plusieurs de ses illustrations. C’est donc « Le feu » qui a remporté le plus de suffrage. Deux anecdotes sur cette illustration au passage : d’une part, c’était celle que j’aurais choisi si j’avais établi une dictature littéraire, et d’autre part, George Barbier était nantais et est né dans la rue derrière la boutique de Tepthida (La Fabrique Onirique, spécialisée dans le steampunk) !
Ce qui me plait dans ce format, c’est d’être surpris d’un texte à l’autre, d’établir des liens entre des événements, pourtant évidents, et auxquels je n’avais pas songé. Comme le dit si bien l’autrice (et traductrice) Mélanie Fazi dans l’épisode du podcast Procrastination consacré aux nouvelles, chaque texte est en capacité d’ouvrir un univers plus vaste que ce qu’il présente…
Enfin, j’ai soif de découvertes. Je veux découvrir des auteurs, de nouvelles plumes. Sur Dimension : Routes, j’ai rencontré Tepthida, j’ai découvert la plume de Floriane Soulas que je suis depuis, tout comme celle d’Emmanuel Chastellière. La littérature crée des ponts entre les gens. Des amitiés se nouent au fil du travail éditorial…
Tepthida Hay : Pour ne pas lasser le lecteur, il faut à mon sens éviter les redites de sujet – à qualité égale. Certains thèmes laissent peu de marge de manœuvre (c’est là que la partie recherche entre en jeu), ou alors le thème peut être très classique mais mené par une écriture incroyable, et là la magie opère. J’adore ce format, car il permet une immersion rapide dans une histoire. La nouvelle a ce pouvoir de nous transporter dans une époque, un univers, une ambiance en quelques paragraphes. Par ailleurs, pour les anthologies thématiques, il est assez fascinant de voir quel traitement a été fait du thème. Et c’est aussi très intéressant quand on a tenté l’appel à textes sans succès.
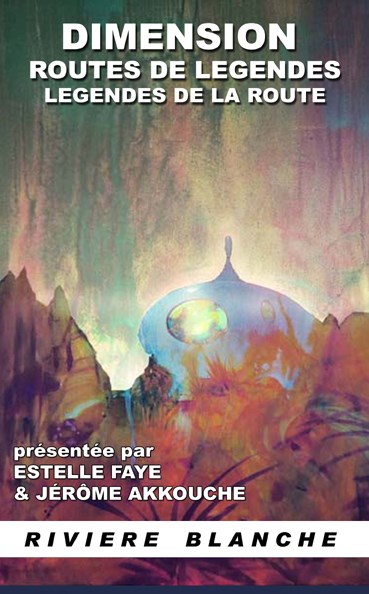
Actusf : Les Années folles à la sauce SFFF… Qu’est-ce que cela implique comme contraintes ? Pourquoi opter pour le genre de l’imaginaire ? Cela permet d’aborder des sujets sensibles ?
Jérôme Akkouche : Tout d’abord, je dirais que les contraintes offrent de grandes libertés, et que nos auteurices ont parfaitement su en jouer. Tepthida et moi avons été très attentifs lors de la sélection des textes à ce que ceux-ci ne puissent se dérouler que durant les Années folles. S’il s’agissait de changer un mot pour un autre pour changer de période, le texte était écarté. Aussi les auteurices ont su prendre en compte faits historiques, avancées technologiques, mœurs, modes, etc. Mis à part ce carcan, aucune limite n’était envisagée.
Pourquoi opter pour l’Imaginaire ? Eh bien, comme Tepthida, je lis énormément de SFFF, et je suis toujours en quête de surprises. La SFFF permet d’avancer masqué pour mieux aller au fond des choses, d’être plus critique, plus pertinent face à des problèmes contemporains. On dépasse le cadre du témoignage, ou du roman de « littérature générale » qui se veut être « une somme » (voire même un pensum). La SFFF, elle, s’en moque. Elle promet déjà une histoire, vous l’offre, et en fin de compte, elle vous enrichie d’une pensée sur l’être humain ou sur le monde (lisez tout Becky Chambers !). Alors, oui, la SFFF permet d’aborder des sujets sensibles, et avec les Années folles, nous sommes servis : entre une pandémie mondiale de grippe espagnole au sortir de la guerre, la montée du fascisme partout en Europe, et la crise financière qui couronne le tout, on est (hélas) salement d’actualité avec notre anthologie…
Tepthida Hay : Cela implique de se replonger dans l’Histoire de cette décade précise, d’en cerner les contours si spécifiques (l’entre-deux-guerres), de connaître les mécanismes psychologiques, économiques, moraux qui l’ont façonnée. Pour la sauce SFFF, c’était une évidence : je ne lis pratiquement que de l’Imaginaire. J’ai toujours été fascinée par la liberté offerte par les littératures de (mauvais) genre. Lire une histoire ordinaire traitée de façon ordinaire ne m’intéresse pas, je veux voyager, frissonner, douter, me laisser surprendre par une réalité autre. Et comme c’était le cas de Jérôme aussi, il n’y avait plus qu’à ! L’imaginaire, je trouve, permet plus d’amplitude pour traiter un sujet, même douloureux. C’est là la beauté de la chose, face aux horreurs, aux inégalités de ce monde, l’imaginaire propose une explication, une échappatoire parfois. Les humains aux comportements indéfendables ne sont-ils pas plutôt de véritables monstres ?
Actusf : Qu’est-ce qui vous fascine dans la période des Années folles ?
Jérôme Akkouche : La chance manquée de changer durablement et profondément la face du monde, rien de moins ! D’un côté, il y a cet élan vital des survivants du premier conflit mondial, et de l’autre, la catastrophe à venir de la Seconde Guerre mondiale. Mussolini est président du conseil italien dès 1922, Hitler publie Mein Kampf en 1925… et le Krach de 1929 siffle la fin de la fête…
Sur une note plus légère, je trouve l’esthétique de cette période toujours audacieuse, les meubles « design » que l’on trouve aujourd’hui sont de pâles copies de ce qui se faisait il y a un siècle… Les révolutions artistiques sont induites essentiellement par des étrangers : Paris est un creuset où Espagnols (Picasso…), Américains (Hemingway…), Japonais (Fujita…), Russes (Soutine…) modifient durablement la face du monde… Certes, les Français ne sont pas en reste, mais tous semblent ne former qu’une seule famille où les collaborations sont multiples. Qui ne connaît pas les photographies de Kiki de Montparnasse par Man Ray ? Au début de cette réponse, je parlais de « chance manquée »…. Mais cette chance a bien été saisie dans le domaine de l’Art et elle nous influence encore profondément !
Tepthida Hay : C’est assez fascinant de voir la frénésie créative et les changements radicaux apportés en quelques années dans des sociétés occidentales plutôt rigides. Ce n’était pas du tout l’image que je me faisais des années 1920, j’imaginais une société encore un peu fossilisée dans les codes du XIX° siècle. Bon, il ne faut pas oublier que la décadence des folles fêtes mondaines n’a concerné qu’une infime part de la société (américaine, française, allemande, etc.), une toute petite part aisée, que le monde occidental demeurait encore plutôt rural et ne s’amusait pas à jeter l’argent par les fenêtres. Mais l’empreinte laissée par ces noceurs est durable, elle a traversé un siècle entier et suscite immédiatement des images (parfois clichées). Dites « Années folles », et les gens répondront charleston, Gatsby, coupe garçonne, jazz, etc. L’imaginaire de cette époque révolue est toujours bien vivace, elle fait régulièrement son revival, à l’occasion de la sortie d’un film, d’une tendance de la mode qui pioche dans le passé, d’une soirée à thème. Quant au monde artistique : l’expérimentation, l’audace en ont été la clef. L’émulation de ces milieux a créé des œuvres atemporelles.

"Kiki, Noire et Blanche", présentée dans le cadre de l'exposition "Jazz Age" au Cleveland Museum of Art de Cleveland, Ohio, aux États-Unis
Actusf : Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Jérôme Akkouche : J’ai une actualité assez chargée, je vais bientôt me plonger dans les corrections éditoriales de ma nouvelle aux Éditions du Chat Noir, « La justice des ogres », qui paraîtra dans l’anthologie 9 à la mi-2021. Je me documente afin d’écrire un synopsis de roman d’Urban Fantasy dans l’univers de cette nouvelle.
Je suis en attente de la réponse d’un éditeur pour mon roman de « Gatsbypunk », c’est-à-dire un roman steampunk (et uchronique) se déroulant en 1925… Quand je vous dis que les Années folles sont une obsession !
Enfin, je travaille en tant que bêta lecteur sur le prochain roman jeunesse d’Estelle Faye, dont on pourra reparler bientôt, et celui de Floriane Soulas qui est prévu en 2021.
Tepthida Hay : Là, je termine deux nouvelles. J’essaie de répondre à quelques appels à textes SFFF par an quand mon activité professionnelle m’en laisse le temps. Mais j’aimerais, pourquoi pas, renouer avec le roman plus tard. J'ai envie d'écrire un roman steampunk, ainsi que deux romans d'Urban Fantasy. Le manque de temps reste le gros obstacle, et aussi le formatage « nouvelliste » (est-ce que mon récit pourrait tenir dans la longueur?). Mais je suis sûre de surmonter cela !