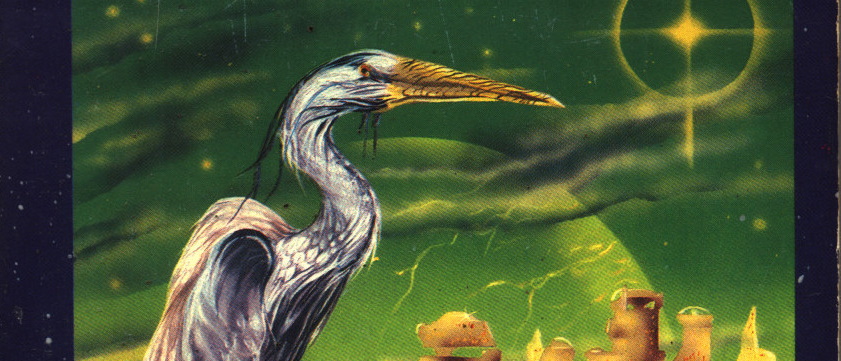Parmi les auteurs de science-fiction qui auraient mérité un Nobel de littérature, Ursula K. Le Guin figurait en très bonne place. Fille d’Alfred et Theodora Kroeber, un couple d’anthropologues américains de premier plan, elle a tout naturellement orienté ses œuvres vers la découverte des civilisations extra-terrestres, et de l’impact de la colonisation humaine sur celles-ci. Le cycle de l’Ekumen, qui rassemble une grande partie de ces fascinants planet operas, comporte des réussites majeures comme La main gauche de la nuit, ou Les dépossédés. Passionnée de poésie, elle a publié plusieurs recueils qui n’ont malheureusement pas encore été traduits en français, mais cet aspect de ses talents est particulièrement présent dans son célébrissime cycle de fantasy, Les contes de Terremer, une autre très grande réussite. Avec la publication récente de Mener sa barque, un essai consacré à l’écriture, cette pédagogue avertie a permis aux auteurs et lecteurs passionnés de comprendre de nombreux points techniques importants. Madame Le Guin a-t-elle jamais écrit un livre ennuyeux ou sans intérêt ? A la lecture du très beau L’œil du héron, presque introuvable depuis plus d’un quart de siècle, il est permis d’en douter…
Nouveau monde et vieilles querelles…
Devenus indésirables sur Terre, les partisans les plus virulents des régimes autoritaires ont été exilés sur une lointaine planète, Victoria, où ils ont fait prospérer une culture pour le moins psychorigide. Deux siècles plus tard, à la suite de nouveaux renversements politiques, ce fut le tour des pacifistes ! Envoyés eux aussi sur Victoria, ils y fondèrent une communauté libertaire et non violente, que les précédents colons s’efforcèrent bien entendu d’exploiter… Mais lorsque les pacifistes envisagent de découvrir de nouveaux territoires sur cette planète encore inexplorée, les dirigeants de la Cité s’y opposent, craignant de perdre une partie de leurs serfs. Comment la communauté va-t-elle répondre à l’agressivité des despotes sans renier ses convictions ? Lorsque l’on doit composer avec l’intransigeance d’un système totalitaire et répressif, un terrain d’entente est-il réellement impossible ?
Liberté, égalité, parité…
Même s’il n’appartient pas ouvertement au Cycle de l’Ekumen, L’œil du héron n’en est pas moins représentatif du travail d’Ursula Le Guin. Elle s’y inspire de l’histoire pour bâtir deux sociétés que tout oppose, l’une dont l’organisation politique évoque l’Allemagne des années trente tandis que l’autre se réfère ouvertement à l’ahimsa (non-violence) chère à Ghandi. Imprégné de philosophie orientale jusque dans sa structure, L’œil du héron illustre la manière dont deux forces en apparence antagonistes se nourrissent mutuellement pour se transformer peu à peu sous l’influence déterminante de la douceur. Ursula Le Guin, qui comprenait parfaitement le taoïsme — elle a même publié une traduction-interprétation du Dao de jing — en utilise les principes pour mener son récit jusqu’à une fin ouverte qui rappelle que toute conclusion est provisoire et mène à de nouvelles aventures selon la seule loi vraiment immuable : celle du changement. L’œil du héron donne à penser, avec une grande simplicité, et s'appuie davantage sur la psychologie des personnages que sur un décor exotique ou des rebondissements en cascade. Nous sommes ici bien loin du sense of wonder ou d’une littérature qui ne viserait qu’au divertissement. Exercice du pouvoir, besoin de liberté, résistance passive, et même féminisme, voilà un livre de moins de deux cent pages qui se révèle finalement beaucoup plus dense qu’on aurait pu le supposer au premier abord. Pour ceux qui aiment les récits courts et intelligents, sans faire l’impasse sur les sentiments et l’aventure, c’est un volume à se procurer sans attendre !