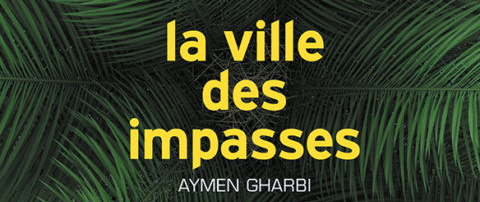A l'occasion de la sortie de La Ville des impasses, Aymen Gharbi revient sur l'écriture de ce nouveau roman paru aux éditions Asphalte.
Actusf : Comment est née l'idée de ce roman ? Votre action se situe en 2042 dans la ville de Xoxox. Comment avez vous imaginé et construit cette ville ?
Aymen Gharbi : L’idée me vient d’une petite mésaventure que j’avais vécue en 2017 en me rendant chez des amis éditeurs à Tunis pour travailler sur un livre qu’ils allaient faire paraître. En chemin, je me suis perdu dans une infinité d’impasses. Dans chaque impasse quasiment, il y avait un gardien absurde qui me sommait de revenir sur mes pas, parce qu’il devinait que j’étais étranger au quartier. J’ai ressenti tout cela comme une restriction à ma liberté de circuler. Et de ce mélange entre l’ambiance éditoriale qui m’attendait chez mes amis et cette errance restrictive qui n’en finissait pas, m’est venue l’idée de ce livre : une ville imaginaire entièrement composée d’impasses, avec une tension sociale particulière.
Actusf : Est-ce que Xoxox est selon vous aussi un personnage à part entière ?
Aymen Gharbi : Oui. Mais c’était aussi le cas de Tunis dans mon premier roman, et de toute fiction urbaine en général. Ici, le travail sur la personnalité de cette ville était difficile à définir, parce qu’il s’agissait d’une ville imaginaire, créée en France dans le futur. En tous cas, le caractère rigide et froid de Gravimal, le bâtisseur de cette ville, a été très important pour lui donner une âme.

Actusf : Est-ce que vous pouvez nous parler de Paoletta ? Comment la voyez-vous et comment pourriez-vous nous la présenter ?
Aymen Gharbi : C’est une tueuse à gages originaire de Villagio Coppola en Italie, une autre ville nouvelle catastrophique mais réelle, qui Elle est venue à Xoxox pour assassiner Gravimal. Mais petit à petit, ce contrat alimentaire va devenir une quête existentielle pour elle. Elle est une métaphore extrême de la détestation d’une frange des citoyens pour les institutions. Je l’ai imaginée en lisant un ouvrage génial de Philippe Trétiack : Faut-il pendre les architectes ? (Seuil). Trétiack y critiquait, par ce titre provocateur, les édifices publics construits par des mégalomanes institutionnels, exactement dans le profil de Gravimal. Et ces mégalomanes continuent d’ailleurs de construire des projets toujours plus démesurés : une quarantaine de villes nouvelles sont envisagées actuellement dans le monde. Il y a un mois environ, le prince Salman d’Arabie Saoudite a annoncé The Line, une ville tout en longueur, sans rues et sans voitures. Bill Gates veut construire une ville en Arizona. Toutes ces villes seront « écologiques, intelligentes et hyper connectées », nous dit-on. Comprenez : des cauchemars hyper surveillés qui, en se généralisant, risquent de provoquer des rejets violents, comme celui vécu par Paoletta.
Actusf : On peut lire dans votre roman un discours écologique mais aussi des mises en garde contre l'autoritarisme et la dictature. Est-ce que c'était le sens de votre écriture, une forme d'engagement et d'alerte pour le lecteur ?
Aymen Gharbi : C’est une tentative littéraire de comprendre comment « l’image d’une idée se déforme toujours quand elle se réalise », pour citer Stefan Zweig. Je tente, entre autres, de sonder quelques impasses, justement, où peut tomber l’écologie, une notion qui sera quand même incontournable pour l’humanité dans les décennies à venir.
Dans mon roman, un bâtisseur allergique aux voitures au point de les considérer comme des insectes nuisibles construit une ville composée d’impasses étroites, pour que ces engins polluants ne puissent pas y circuler. La conception de cette ville a été un vertige intellectuel pour lui, mais ce n’est visiblement pas le cas pour les habitants, qui sont devenus de plus en plus hostiles à cette ville impossible et de plus en plus fliquée. Ils veulent y ouvrir des boulevards, alors que lui s’entête à la laisser telle quelle, en vertu d’un contrat signé avec les pouvoirs publics. Il est aussi persuadé du bienfondé humaniste de sa structure et considère ses opposants comme manipulés.
Quand j’ai commencé à écrire ce texte en 2017, j’étais tombé sur un débat à la télévision avec un titre du genre : « L’autoritarisme écologique est-il la solution au réchauffement climatique ? ». J’ai trouvé cette idée déroutante. Et chaque fois qu’on lance de nouvelles idées à la télé, ça veut dire qu’elles ne vont pas tarder à être appliquées. Et effectivement en 2018, l’une des principales causes de la crise des Gilets Jaunes était une forme d’autoritarisme écologique : on venait de décider la hausse des prix des carburants et de la taxe Carbonne, dans le but dissuader encore plus les gens d’utiliser leurs voitures. C’était une mesure qui avait dû paraitre géniale à ceux qui l’avaient décidée, mais, concrètement, elle avait attisé la colère des habitants des régions rurales, livrés à eux-mêmes après le démantèlement du service public et du transport en commun. J’ai été fasciné par cette atmosphère en écrivant le roman. Et aujourd’hui avec le Covid 19, nous vivons un autre genre d’autoritarisme : l’autoritarisme sanitaire avec des dirigeants qui ne se soucient pas de la vie sociale, culturelle et psychiatrique des citoyens. Ce qui les intéresse en fin de compte, c’est les statistiques, leur carrière et leur propre égo, un peu comme Gravimal.
Actusf : Est-ce que vous avez pensé votre écriture aussi en fonction de la ville et de son aspect labyrinthique, pour mieux nous la faire ressentir ?
Aymen Gharbi : Oui. Il y a l’idée du cul-de-sac. Par exemple, le roman commence et se termine par la même réplique. Xoxox est un palindrome, c'est-à-dire qu’il se lit dans le deux sens. Les territoires décrits sont tous caractérisés par le morcellement et la division. Les dialogues font parler des personnages qui ne se comprennent pas, ou peu. Il y a aussi un refus de s’inscrire dans un genre, pour perdre le lecteur, avant de le ramener vers le chemin du récit.
Actusf : Le roman vient tout juste de sortir, c'est le temps des premières chroniques. Comment vivez-vous cette période ?
Aymen Gharbi : C’est une période à la fois excitante et pénible, parce qu’on expose le fruit de notre imagination aux lecteurs. Ce n’est pas facile, surtout pour un deuxième roman. Il a séduit certains et a désarçonné d’autres, qui ne m’attendaient pas sur ce domaine. Mais c’était le but. Mon premier roman avait suscité des critiques positives. Mais j’avais un désir de rompre totalement avec cet univers pour éviter d’être catalogué dans une case, celle des « écrivains post-révolutions arabes ». Et mes éditrices, Claire Duvivier et Estelle Durand, ont eu le courage d’aller jusqu’au bout avec le débutant que je suis, dans cet imaginaire futuriste et dystopique. C’est aussi l’intérêt, je crois, de travailler avec une maison indépendante qui comprend que je sois concerné par des univers très différents et ne m’enferme pas dans une case. Mais en même temps, La Ville des impasses parle de dictature et de révolution à sa manière. On peut y voir une critique de tous ces présidents, rois et Ubu de tous genres qui ne veulent pas changer de politique, ou qui ne veulent pas dégager, malgré le mécontentement général. Et généralement leurs opposants ne sont pas moins grotesques qu’eux. En France comme en Tunisie, c’est un peu le cas.
Actusf : Quels sont vos projets désormais ? Sur quoi travaillez-vous ?
Aymen Gharbi : Sur un troisième roman qui se passe à Paris, de nos jours, entre Barbès et Montmartre, avec des doubles, des fantômes et beaucoup de peinture.
 Jérôme Vincent
Jérôme Vincent